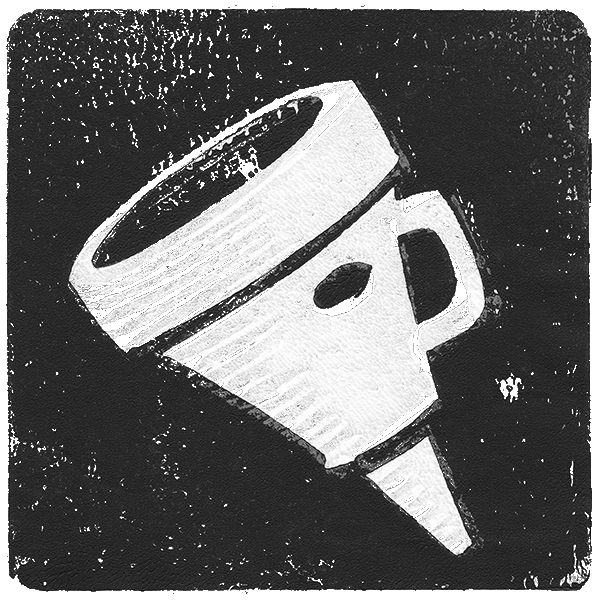
Dans cette maison, il y en avait des entonnoirs. De tous les formats et de tous les genres. Dans la cuisine, bien sûr, pour transvider d’une jarre à l’autre. Mais dans l’atelier aussi. Des entonnoirs plus intrigants encore, souvent crasseux, dont ma mère se servait, je crois, pour mieux huiler les machines à coudre ou pour contrôler des liquides étranges, sans doute interdits, peut-être légèrement toxiques, qui meublaient cette pièce surpeuplée où elle bricolait en appelant ça du travail.
L’atelier était rempli de tabous. Suffisait que mes doigts s’approchent d’un ciseau à tissu pour que mon prénom fuse, prononcé déjà comme une accusation. Je ne pouvais non plus manifester trop de curiosité pour les entonnoirs et autres récipients : ils étaient courbaturés et tachés comme des ouvriers fatigués avant d’avoir cinquante ans. Tout indiquait qu’ils en avaient vu des vertes et des pas mûres et qu’il fallait éviter d’y mettre la bouche, le doigt ou même la pâte à modeler.
Parlant de tabou, il y avait, au-dessus de la porte d’entrée, un petit pot dont la rumeur familiale m’a dit qu’il contenait du mercure. Il s’agissait de quelque sortilège pour chasser le mauvais œil ou sa parenté. Chose certaine : il ne chassait ni la poisse ni les gaffes (les miennes à tout le moins).
Je n’avais le tour avec rien, surtout pas avec mes mains et s’il semblerait logique que l’entonnoir soit devenu mon allié contre les dégâts, il n’en est rien. Je pourrais compter sur les doigts de la main les fois où j’ai su utiliser un entonnoir sans que le contenu soit finalement trop dense pour le contenant. Plus souvent qu’autrement, je finissais encombrée par l’outil inutile, le contenu à moitié dedans, à moitié dehors, obligée de renverser l’entonnoir pour le vider par le grand bout, répandant plus que jamais mes bonnes intentions sur le plan de travail, le plancher et quelques vêtements.
L’enfance déborde. Ni sortilège ni ustensile n’y peuvent rien.